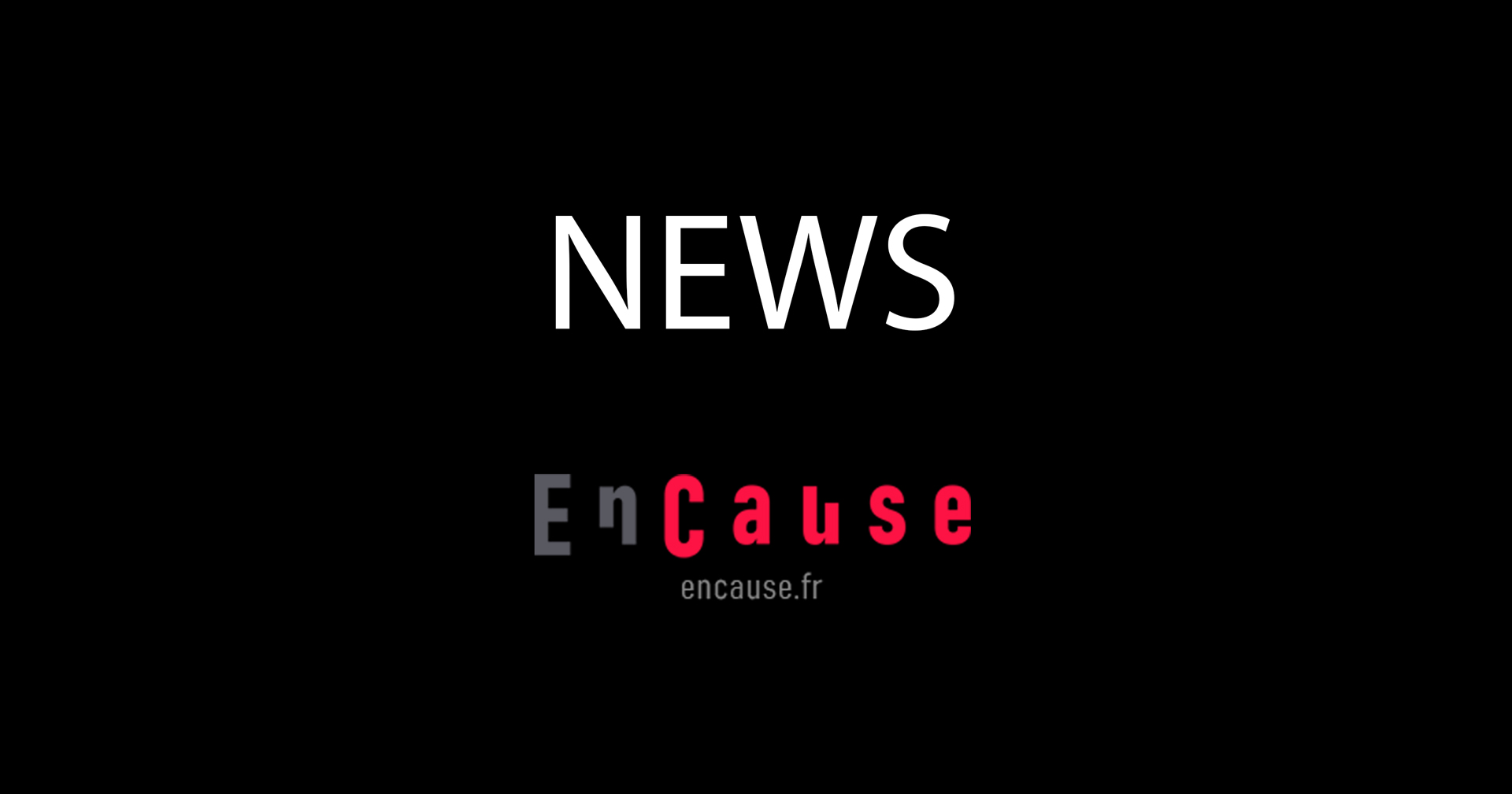Comme si elles n’étaient pas déjà assez dangereuses, les étoiles qui se transforment en supernova peuvent interagir avec les gaz environnants et produire des « torrents » de rayons X capables de modifier l’atmosphère de planètes situées jusqu’à 160 années-lumière de distance. Telle est la conclusion d’une étude réalisée par des astronomes américains, qui ont mis en garde contre le fait que de tels rayonnements pourraient compromettre la couche d’ozone d’une planète et potentiellement provoquer une extinction massive. Heureusement, la Terre n’est pas menacée par cette menace aujourd’hui, selon l’équipe, car il n’y a pas de progéniteurs de supernova suffisamment proches pour nous impacter, mais la planète pourrait avoir été baignée par ces dangereux rayonnements dans le passé.
L’astronome Ian Brunton de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, responsable de l’étude, a déclaré : « Si un torrent de rayons X balaie une planète proche, les radiations altéreraient gravement la chimie atmosphérique de la planète.
« Pour une planète semblable à la Terre, ce processus pourrait anéantir une grande partie de l’ozone, qui protège la vie des dangereux rayonnements ultraviolets de son étoile hôte.
Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les observations en rayons X de 31 supernovae et de leurs conséquences, réalisées par les télescopes Chandra, Swift et NuSTAR de la NASA, ainsi que par l’observatoire spatial XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne.
Leur analyse indique que les interactions entre les supernovae et leur environnement peuvent avoir des conséquences fatales pour les planètes situées jusqu’à 160 années-lumière.
Les scientifiques savent depuis longtemps que les supernovae peuvent affecter les planètes environnantes et nuire à la vie qu’elles pourraient abriter.
Cependant, les études précédentes se sont concentrées sur le danger qui se présente à deux échelles de temps différentes dans le sillage de l’explosion – la première étant dans les jours et les mois qui suivent, en raison des radiations intenses émises par les supernovae.
Le second, quant à lui, résulte des particules énergétiques qui peuvent mettre des centaines voire des milliers d’années à atteindre les planètes qui se trouvent sur leur trajectoire.
Cependant, les chercheurs ont depuis découvert qu’entre ces deux menaces, il en existe une autre. Si les supernovae émettent toujours des rayons X, des émissions secondaires de ce type de rayonnement peuvent également être produites à fortes doses si les ondes de souffle de l’explosion interagissent avec le gaz interstellaire dense.
Ces rayons X peuvent atteindre les planètes voisines dans les mois qui suivent l’explosion initiale et peuvent durer des décennies.
LIRE LA SUITE : Des phénomènes spatiaux étranges qui peuvent tuer
Si la Terre était frappée par un afflux soutenu de rayonnements à haute énergie provenant d’une supernova, cela pourrait entraîner l’extinction d’un grand nombre d’organismes, avec un effet en cascade susceptible de déclencher une extinction massive.
Heureusement, Connor O’Mahoney, co-auteur de l’article et astronome de l’Illinois, a déclaré : « Pour autant que nous le sachions, la Terre n’est pas menacée par un tel événement aujourd’hui.
Cependant, a-t-il ajouté, « il se peut que de tels événements aient joué un rôle dans le passé de la Terre ».
Sur la base de la découverte d’une forme radioactive de fer dans des gisements géologiques contemporains à travers le monde, les scientifiques pensent que des supernovae se sont produites à proximité de la Terre il y a entre deux et huit millions d’années.
Ces explosions auraient pris naissance entre 65 et 500 années-lumière de la Terre.
A NE PAS MANQUER :
La dégustation de vins depuis l’espace, une expérience à 105 000 £, en 2025 [INSIGHT]
La fusée la plus puissante du monde s’enflamme lors d’un vol d’essai [REPORT]
Le mystère des taches sur la plus importante collection de Vinci est résolu [ANALYSIS]
L’étude de la région spatiale environnante, qui forme une sorte de cavité relative dans le milieu interstellaire, où le gaz est moins dense, apporte d’autres preuves que la Terre a été le témoin de supernovae locales dans un passé lointain.
Cette « bulle locale », délimitée par des gaz chauds de faible densité, eux-mêmes entourés d’une coquille de gaz froid, s’étend actuellement sur quelque 1 000 années-lumière.
En se basant sur le fait que la bulle est toujours en expansion, les chercheurs pensent qu’elle a été formée par l’explosion de plusieurs supernovae au sein du groupe mobile des Pléiades, il y a environ 14 millions d’années.
À cette époque, les étoiles responsables de l’explosion de la bulle locale étaient beaucoup plus proches du système solaire qu’elles ne le sont aujourd’hui, ce qui signifie que la Terre était autrefois beaucoup plus exposée au risque de supernovae qu’elle ne semble l’être à l’heure actuelle.
Selon les chercheurs, cette période ne semble pas coïncider avec les événements d’extinction massive connus sur Terre. Cependant, il suggère que des explosions cosmiques ont pu affecter notre planète au cours de son histoire.
Si la vie sur Terre n’a pas à s’inquiéter du risque de supernovae, il est possible que de tels phénomènes entravent le développement de la vie ailleurs dans la Voie lactée, où de nombreuses planètes habitables se trouvent dans le rayon d’explosion de supernovae passées ou futures.
En conséquence, la prise en compte des supernovae pourrait réduire les zones de la Voie lactée propices à la vie – ce que l’on appelle la « zone galactique habitable ».
Le Dr Brian Fields, co-auteur de l’article et astronome, également de l’Université de l’Illinois, a conclu : « La poursuite des recherches sur les rayons X émis par les supernovae est précieuse, non seulement pour comprendre le cycle de vie des étoiles ».
Il ajoute que ces recherches ont des « implications pour des domaines tels que l’astrobiologie, la paléontologie et les sciences de la Terre et des planètes ».
Leur étude initiale étant terminée, les chercheurs recommandent de mener d’autres études sur les supernovae en interaction afin d’améliorer notre compréhension de leur impact.
Les résultats complets de l’étude ont été publiés dans The Astrophysical Journal.