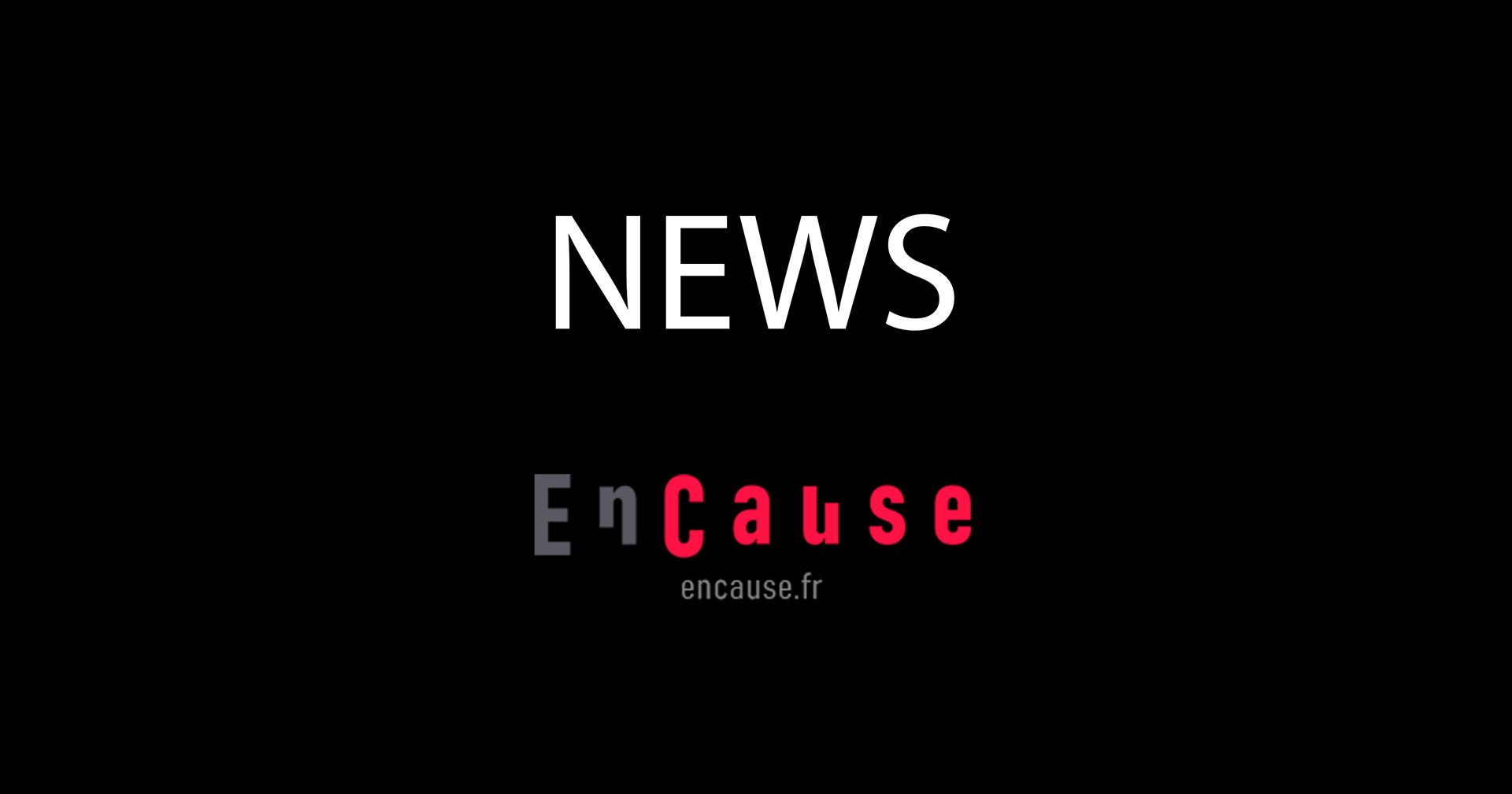Presque aucun endroit de la planète n’est à l’abri de la pollution de l’air, puisque seulement 0,18 % des terres ne sont pas exposées à des niveaux de particules fines ambiantes (PM2,5) actuellement considérés comme dangereux par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Telle est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs australiens, qui a également constaté que 99,999 % de la population mondiale est exposée à des niveaux dangereux de PM2,5. On espère que ces résultats encourageront les décideurs politiques du monde entier à élaborer de nouvelles réglementations pour limiter la pollution de l’air.
Le manque de stations de surveillance de la pollution atmosphérique dans le monde a entraîné un déficit de données sur l’exposition locale, nationale, régionale et mondiale aux PM2.5.
Dans leur étude, le professeur Yuming Guo, expert en santé environnementale à l’université Monash de Melbourne (Australie), a combiné les données disponibles sur la surveillance de la qualité de l’air et les observations météorologiques et de la pollution atmosphérique par satellite pour établir une carte de l’évolution des niveaux de PM2,5 dans le monde au cours des deux dernières décennies.
Le professeur Guo explique : « Nous avons utilisé une approche innovante d’apprentissage automatique pour intégrer de multiples informations météorologiques et géologiques afin d’estimer les concentrations quotidiennes de PM2.5 au niveau de la surface du globe à une résolution spatiale élevée. […] pour la période 2000-2019. »
L’étude, a-t-il ajouté, s’est concentrée « sur les zones où les concentrations sont supérieures à 15 µg/m3 [micrograms per cubic metre]qui était considérée comme la limite de sécurité par l’OMS (le seuil est encore discutable) ».
Au cours des deux décennies en question, l’étude a révélé que la concentration annuelle de PM2,5 et le nombre de jours d’exposition élevée aux PM2,5 ont diminué en Europe et en Amérique du Nord.
En revanche, l’exposition a augmenté en Asie du Sud, en Australie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Nouvelle-Zélande.
À l’échelle mondiale, la moyenne annuelle des PM2,5 entre 2000 et 2019 était de 32,8 µg/m3.
En fait, malgré une légère diminution globale des jours de forte exposition aux PM2.5, en 2019, plus de 70 % des jours présentaient encore des concentrations de PM2.5 supérieures à 15 µg/m3.
LIRE LA SUITE : Les Britanniques souhaitent l’abandon de l’interdiction des émissions nettes zéro pour les nouvelles voitures à essence et diesel
Ce niveau atteint plus de 90 % des jours si l’on considère uniquement l’Asie orientale et l’Asie méridionale, qui ont également enregistré les concentrations de PM2,5 les plus élevées, avec respectivement 50,0 et 37,2 µg/m3.
Selon le professeur Guo, les concentrations ambiantes dangereuses de particules fines présentent également des distributions saisonnières variables.
Il s’agit notamment du nord-est de la Chine et du nord de l’Inde pendant les mois d’hiver (décembre, janvier et février), tandis que les régions de l’est de l’Amérique du Nord présentent des concentrations élevées de PM2,5 pendant les mois d’été (juin, juillet et août).
« Nous avons également enregistré une pollution atmosphérique par les PM2,5 relativement élevée en août et en septembre en Amérique du Sud et de juin à septembre en Afrique subsaharienne.
A NE PAS MANQUER :
Mystère de l’île de Pâques après la découverte d’une nouvelle statue de moai au fond d’un lagon [ANALYSIS]
Sunak est invité à retenir 750 millions de livres sterling du programme spatial de l’UE [INSIGHT]
La facture d’énergie est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, alors que Shapps est pressenti pour supprimer l’augmentation de 3 000 £. [REPORT]
Selon le professeur Guo, l’étude est importante car « elle permet de mieux comprendre l’état actuel de la pollution de l’air extérieur et son impact sur la santé humaine ».
« Grâce à ces informations, les décideurs politiques, les responsables de la santé publique et les chercheurs peuvent mieux évaluer les effets à court et à long terme de la pollution de l’air sur la santé.
Il en conclut que cela pourrait contribuer à l’élaboration de nouvelles stratégies de réduction de la pollution atmosphérique.
Les résultats complets de l’étude ont été publiés dans la revue The Lancet Planetary Health.